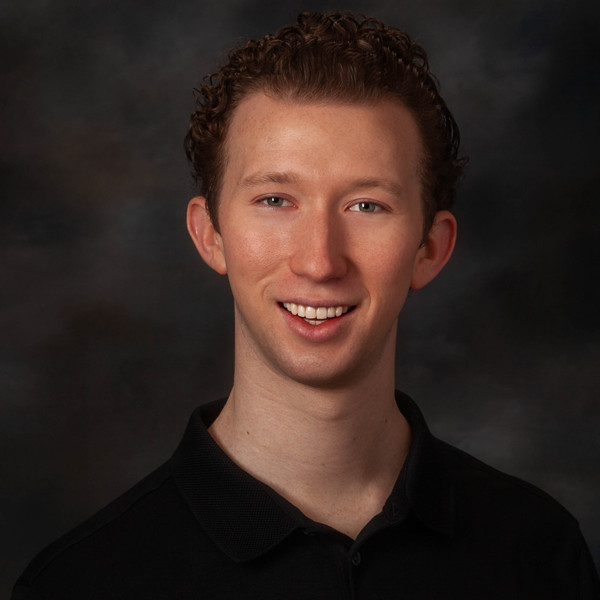Le long parcours de l’expérience de vie influence les résultats économiques du monde réel, pour les décideurs autant que pour les consommateurs
Le 29 octobre 1929, les folles années 20 s’arrêtent brutalement aux États-Unis avec le fameux « mardi noir », au cours duquel le marché boursier américain s’effondre. Il faudra attendre longuement, jusque dans les années 50, pour qu’il retrouve son niveau record de l’époque.
Cette crise de 29 n’a pas eu des répercussions que sur le marché boursier, elle a frappé aussi les populations obligées de grossir les rangs de la soupe populaire ou de dormir dans des taudis. Ceux qui ont grandi pendant cette crise de 29, les « bébés de la crise », se sont avérés être une génération incroyablement austère et peu disposée à prendre des risques, surtout en bourse. Le traumatisme subi a transformé toute une génération, dans ses croyances, dans sa vision du monde et dans ses choix économiques — sur les marchés financiers, sur les marchés du travail et dans tant d’autres aspects de la vie.
En science économique, ces enfants de la crise en sont venus à faire l’objet d’une nouvelle vague de recherche en économie comportementale : une recherche plus large, qui au-delà de ses fondements en psychologie et en économie, va puiser des connaissances et des méthodes dans les sciences sociales et naturelles avoisinantes. Nombre de nouveaux sujets et méthodes d’études sur les traumatismes, le stress, la dépendance, la santé mentale et le développement de l’enfant sont intrinsèquement axés sur cette démarche. Ils sont directement liés aux travaux menés par Anne Case et Angus Deaton sur ce qu’ils ont appelé les « morts du désespoir » au XXIe siècle et à la persistance des rôles de genre et de la discrimination raciale.
Les débuts de la science économique comportementale
Revenons toutefois en arrière pour en retracer brièvement l’origine. Il y a plus de 50 ans, à la fin des années 60, la science économique reposait confortablement sur la rigueur et les modèles mathématiques, et les plus éminents économistes de l’époque, Paul Samuelson et Milton Friedman, se sentaient plus apparentés aux physiciens qu’aux psychologues. Toutefois, à peu près à la même époque, deux psychologues israéliens, Daniel Kahneman et Amos Tversky, se sont rencontrés à l’Université hébraïque de Jérusalem et ont entamé une collaboration qui allait finir par bouleverser le statu quo en science économique. Leur recherche la plus célèbre, qu’ils présentent en 1979 dans leur théorie des perspectives, regroupe plusieurs principes pour décrire le processus de prise de décision face à des risques : des principes qui semblaient tout à fait plausibles et qui étaient également incompatibles avec la science économique traditionnelle. Selon l’un d’entre eux, les personnes sur-pondèrent les probabilités infimes et sous-pondèrent les événements probables (autrement dit, l’infime probabilité d’un accident d’avion nous perturbe-t-elle, par exemple ?). Selon un autre grand principe, les personnes attachent de l’importance à l’évolution de leur richesse relative et ont profondément horreur des pertes (elles peuvent être furieuses d’avoir perdu 20 dollars, même si cela n’a que très peu d’effet sur leur richesse totale). À elle seule, cette théorie des perspectives a été jugée digne du prix Nobel d’économie, mais Kahneman et Tversky ont apporté à la pensée économique bien d’autres contributions psychologiques sur les « heuristiques et stéréotypes ».
Une fois la flamme de la science économique comportementale allumée, le flambeau a été transmis aux chercheurs en économie et en finance pour poursuivre les travaux. Richard Thaler, lauréat du prix Nobel d’économie en 2017, a collaboré avec Kahneman et Tversky, et publié par la suite une série spéciale d’articles intitulée Anomalies sur des phénomènes que la science économique dénuée de psychologie ne pouvait pas expliquer, notamment la raison pour laquelle les cours des actions ont tendance à augmenter en janvier.
À cette époque, la science économique comportementale s’employait à détecter les anomalies et à les expliquer en proposant des solutions psychologiques. Une fois les modèles théoriques en place, une deuxième vague d’économistes comportementaux ont commencé dans la première décennie 2000 à se consacrer à documenter empiriquement les biais comportementaux — avec souvent des effets considérables dans le monde réel — et à les intégrer dans d’autres domaines de la recherche économique. À titre d’exemple, l’une des grandes énigmes de l’économie du développement est de savoir pourquoi les possibilités d’investissement rentables, telles que l’épandage d’engrais, peuvent être si rarement adoptées : l’idée que les personnes attachent de l’importance à l’évolution de leur richesse relative et ont horreur des pertes (si l’engrais n’améliore pas le rendement de leur récolte, par exemple) peut contribuer à percer ce mystère.
En fait, la science économique comportementale s’est si bien intégrée dans presque tous les domaines de la science économique — finance, travail, secteur public, développement, macroéconomie — au cours de cette deuxième vague de recherche comportementale que certains auraient raisonnablement pu penser que « c’en était terminé ». Nous avons insufflé le réalisme psychologique à l’Homo economicus classique, cet agent économique qui procède toujours à ses choix de manière optimale et qui ressemble plus à un ordinateur qu’à un être humain.
Un esprit et un corps
Mais voici le problème : si nous considérons l’Homo economicus comme un ordinateur, la science économique comportementale a introduit l’idée que cet ordinateur peut avoir un logiciel défectueux et qu’il peut occasionnellement tomber en panne. Et pourtant, même avec de telles défaillances, l’agent comportemental est resté un ordinateur, même s’il fonctionne mal. Quel que soit le mode de programmation — avec une dose d’optimisme excessif, de biais de récence ou d’illusion quant au coût irrécupérable — c’est l’ordinateur qui dicte pour toujours le mode d’action de l’agent comportemental.
Et incontestablement, ce n’est pas ce qui s’est passé avec les enfants de la crise de 29. Leur expérience les a profondément transformés. En fait, chaque génération ne partage-t-elle pas des expériences communes qui la transforment ? C’est pourquoi nous donnons des noms à ces générations, l’expression « baby-boomers » désignant notamment les personnes nées dans l’expansion de l’après-guerre.
Telle est la contribution que vise à apporter la vague la plus récente d’économie comportementale. L’être humain est bien plus qu’un ordinateur, même doté d’un logiciel défectueux. Il est un organisme vivant, qui respire et qui est influencé par son propre parcours de vie. Nombre de chercheurs en économie — en économie de la santé et en neuroéconomie, par exemple — expliquent depuis longtemps que nous ne pouvons pas ignorer les mécanismes biologiques qui régissent notre corps et recâblent notre cerveau. Nous sommes maintenant en mesure de voir plus systématiquement les pièces manquantes : l’être humain a un esprit et un corps ; une science économique qui veut décrire le comportement humain doit tenir compte des deux.
Comment cette contribution peut-elle nous aider à améliorer la science économique ? Revenons aux bébés de la crise de 29 et à la manière dont la recherche économique a conceptualisé ce qui est arrivé à leur génération. Les recherches en neurosciences et en neuropsychiatrie nous apprennent que notre expérience personnelle antérieure modifie la façon dont nous sommes câblés. Des décennies de recherche en neuroplasticité montrent que le cerveau humain ne cesse de réorganiser ses parcours en fonction de nouvelles expériences. Plus certains parcours sont utilisés, plus ils se renforcent. En revanche, les parcours moins utilisés s’étiolent peu à peu. Ainsi, outre les effets de la faim et du stress, la crise de 29 a également eu une incidence continue sur le cerveau des personnes. Cette expérience leur a démontré que les marchés financiers présentent un danger pour la vie réelle et qu’ils peuvent les empêcher de nourrir leur famille. En conséquence, les adolescents et les jeunes adultes qui ont vécu la crise des années 30 ont été beaucoup moins tentés d’intervenir sur le marché boursier plus tard dans leur vie : seuls 13 % d’entre eux ont investi en bourse, soit moins de la moitié de ceux des générations suivantes.
Les effets de l’expérience
Le concept des effets de l’expérience démontre l’influence durable des expériences personnelles de la vie sur nos croyances et nos décisions. Ce concept remet en question la pensée économique traditionnelle selon laquelle nous utilisons toutes les informations disponibles pour nous forger une opinion. Il consiste notamment à modéliser la pensée humaine et la prise de décision face au risque en accordant davantage d’importance aux résultats que nous avons personnellement observés dans le passé. Si nous avons été témoins d’un krach boursier phénoménal, nous allons supposer que cela peut se reproduire et, par ailleurs, que ce risque est élevé. En fait, les données sur les investissements boursiers aux États-Unis le confirment depuis des décennies : les investisseurs ayant connu une baisse des rendements boursiers au cours des années antérieures sont moins susceptibles d’investir en bourse que ceux ayant eu une expérience positive.
Mais les effets de l’expérience ne se limitent pas aux événements récents. Il faut savoir que les différentes générations sont façonnées différemment, et peuvent donc aussi réagir différemment à un même événement récent. Une personne de 60 ans va réagir très différemment à une crise financière et à un krach boursier qu’une personne de 30 ans, tout simplement parce qu’elle a vécu beaucoup plus de choses au cours de sa vie et fait intuitivement la moyenne de toutes ces expériences. La personne de 30 ans en a vécu beaucoup moins, et une crise subie récemment va donc occuper une plus grande partie de sa vie et influencer davantage sa réflexion et sa prise de décision. Cela ne veut pas dire que Kahneman et Tversky se sont trompés sur le simple biais de récence, bien au contraire ! Nous faisons preuve d’un biais de récence évident, en accordant plus d’importance aux informations récentes qu’aux informations très anciennes. Mais seules les expériences personnelles de toute une vie comptent, et c’est par rapport à celles-ci que nous évaluons les nouvelles expériences.
Les données boursières révèlent d’autres aspects intéressants de la prise de décision par l’être humain, notamment que les effets de l’expérience sont « spécifiques à un domaine » : les expériences n’ont d’importance que pour les décisions prises dans ce même domaine. Par exemple, l’expérience du marché boursier ne semble pas influencer l’investissement sur le marché obligataire. La recherche révèle aussi que les expériences spécifiques à un domaine peuvent s’étendre au-delà des seuls rendements des actions ou des obligations. Des études connexes sur les investissements en bourse des Allemands de l’Est et de l’Ouest montrent que ceux qui ont vécu sous le communisme sont beaucoup moins susceptibles de faire confiance au marché boursier et d’investir dans des actions, même des années et des décennies après la réunification de l’Allemagne. Des années d’exposition à la propagande psychologique dénonçant le marché boursier comme le summum du capitalisme qui ne bénéficie qu’à une minorité, semblent avoir laissé des traces.
Les émotions, qui influencent nos perceptions, jouent également un rôle. Les Allemands de l’Est qui ont relativement bien vécu sous le régime communiste — même selon des critères non financiers, comme le fait de vivre dans l’une des célèbres villes vitrines du communisme — sont les plus virulents à dénoncer les méfaits du marché boursier et du capitalisme. En revanche, ceux qui ont souffert du régime communiste — de la grave pollution de l’air en Allemagne de l’Est, par exemple, ou de la répression religieuse — sont beaucoup plus disposés à adhérer à l’économie de marché post-communiste.
Ces concepts des effets de l’expérience semblent s’appliquer à presque tous les domaines de la vie. Les expériences de chômage laissent des séquelles et accentuent la prudence des consommateurs, même de nombreuses années plus tard, lorsqu’ils ont des emplois stables et bien rémunérés. Les banques sous-capitalisées ont des coefficients de fonds propres supérieurs aux autres. Les expériences vécues en matière de rendement sur le marché obligataire influencent l’investissement dans les obligations. Les personnes ayant un statut socioéconomique plus élevé ont tendance à avoir des perspectives économiques plus optimistes.
L’inflation est une autre variable macroéconomique analysée fréquemment par les décideurs et, comme il faut s’y attendre, les expériences vécues en matière d’inflation semblent avoir une nette influence sur les opinions et les décisions des individus à cet égard. Selon des travaux de recherche sur plus de 50 ans de données d’enquête relatives aux anticipations d’inflation, l’inflation moyenne observée par les gens au cours de leur vie influence fortement leurs anticipations d’inflation réelles. Et ces anticipations fondées sur l’expérience influent sur des résultats essentiels dans le monde réel — par exemple, sur le choix d’acheter une maison. Il s’avère que l’achat d’un logement, plutôt que la location, est essentiellement motivé par le désir de se prémunir contre l’inflation. En conséquence, les personnes ayant connu une inflation plus élevée sont plus susceptibles de choisir l’accession à la propriété plutôt que la location et un prêt hypothécaire à taux fixe plutôt qu’un prêt à taux variable, toujours pour se protéger contre la hausse de l’inflation (et des taux d’intérêt).
Les effets de l’expérience vont même encore plus loin : l’une des énigmes de l’inflation, observée par la Réserve fédérale aux États-Unis et constatée dans nombre d’autres pays, est que les anticipations d’inflation sont systématiquement plus élevées chez les femmes que chez les hommes. Cette énigme a pu être percée grâce aux effets de l’expérience qui mettent en évidence une différence d’expérience fondamentale entre les hommes et les femmes : les courses d’épicerie. Ce n’est que dans les ménages où elles sont les principales responsables des courses que les femmes ont des anticipations d’inflation plus élevées que leurs partenaires masculins. Dans la mesure où les prix des denrées alimentaires ont connu une inflation plus élevée (ou du moins une volatilité plus prononcée — et, comme les recherches antérieures l’ont montré, les consommateurs retiennent davantage les hausses), les personnes chargées des courses ont des anticipations d’inflation plus élevées. Tant que les rôles de genres attribueront à un plus grand nombre de femmes que d’hommes la responsabilité des courses d’épicerie, les expériences vécues continueront d’être différentes, de même que les croyances correspondantes.
Des décideurs partiaux
Même les décideurs de haut niveau se comportent en fonction des effets de l’expérience (ils ont un cerveau humain, après tout). Les prévisions d’inflation du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale ont tendance à être biaisées en fonction de l’inflation que ces personnes ont connue au cours de leur vie et à s’écarter des prévisions des analystes et des experts en la matière. Ce biais affaiblit la précision des prévisions des gouverneurs de la Réserve fédérale.
Henry Wallich, qui a grandi pendant l’hyperinflation des années 20 en Allemagne, puis est devenu gouverneur de la Réserve fédérale des États-Unis en 1974, représente un cas extrême. Au cours de son mandat, il a été en désaccord un nombre record de 27 fois avec ses collègues, car pour lui, l’inflation devait être la priorité absolue de la Réserve fédérale.
Les quatre caractéristiques essentielles des effets de l’expérience qui influencent les décideurs autant que le consommateur moyen sont exactement les mêmes :
- les effets durables de l’expérience,
- l’importance plus prononcée des événements plus récents,
- les effets de l’expérience spécifiques à un domaine,
- l’effet négligeable des connaissances acquises par rapport aux croyances fondées sur l’expérience, même faussée.
Les effets de l’expérience guident donc les interventions et les programmes de lutte contre les crises à plusieurs égards essentiels. Tout d’abord, les décideurs sont généralement obligés d’arbitrer entre la résolution rapide d’une crise et le coût que cela représente. Les répercussions durables des effets de l’expérience démontrent clairement qu’il est avantageux de résoudre rapidement une crise. Les répercussions de la récente période inflationniste sur les opinions, par exemple, risquent d’influencer pendant longtemps les réactions des gens face aux fluctuations de prix. Plus la période est courte et modérée, moins il y a de séquelles à long terme. À l’inverse, plus l’expérience de la crise est traumatisante, plus elle hante les gens longtemps, même des années plus tard, comme ce fut le cas lors de la crise de 29.
Deuxièmement, les données sur les effets de l’expérience montrent que les décideurs doivent tenir compte des différentes expériences de leurs populations cibles. Une même intervention peut donner lieu à des réactions très différentes selon la manière dont les événements antérieurs ont forgé le comportement et les perspectives des gens. Idéalement, il conviendrait d’adapter toutes les mesures à chaque cohorte de pays/d’âge/de genre ou au moins de prendre en compte ses expositions aux différentes expériences tout au long de la vie.
Enfin, l’apprentissage par l’expérience détermine l’adhésion aux mesures prises, en offrant des possibilités beaucoup plus concrètes que de simples informations. La participation directe, par exemple sous forme d’une intervention pilote, peut nettement plus influencer les préférences que des explications théoriques. La loi sur les soins abordables aux États-Unis (« Obamacare ») en est un exemple. Les personnes bénéficiant d’une assurance maladie gouvernementale qui ont obtenu des prestations directes et immédiates ont été plus disposées à soutenir cette loi. Les républicains, sceptiques au départ, se sont montrés particulièrement disposés à la soutenir, démontrant clairement la supériorité de l’expérience sur l’esprit partisan. Les programmes pilotes permettent aux décideurs d’essayer de nouvelles mesures et d’évaluer la réaction de l’opinion publique. Les expériences personnelles positives des participants aux programmes pilotes peuvent favoriser et garantir une adhésion durable de l’opinion publique.
Les opinions exprimées dans la revue n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique du FMI.